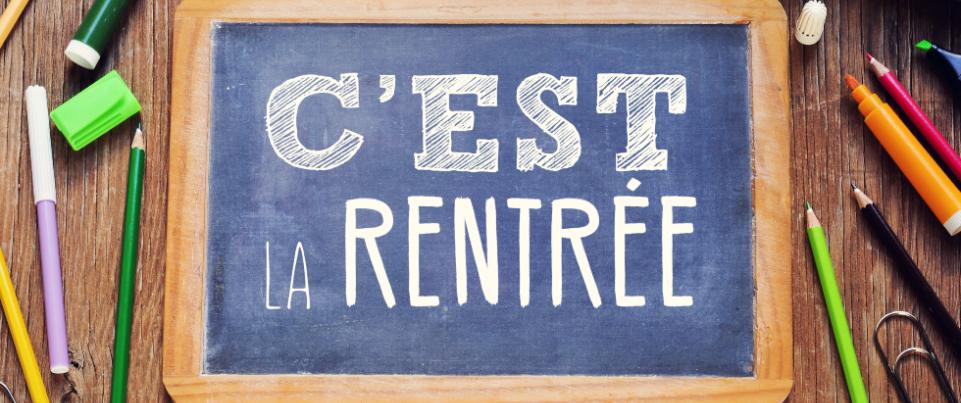Olivier Marty, maître de conférences rattaché au laboratoire Apprentissage, Didactique, Evaluation et Formation, vient interroger les inégalités éducatives par le prisme du projet éducatif que les parents ont pour leurs enfants et les difficultés qui peuvent en découler.
Education et reproduction sociale
Lorsque l’on parle d’inégalités
éducatives, l’on pense souvent aux
institutions d'apprentissage de l'Etat
telles que les écoles par exemple. Bien
que ces dernières soient ornées de la
devise républicaine « Liberté, Egalité,
Fraternité », force de constater que ce
n’est pas parce que l'enseignement
dispensé dans les écoles et les
établissements publics est gratuit et
obligatoire jusqu’à 16 ans, que l’égalité
est atteinte.
Là où l’on
voudrait croire que l’école libère de sa
condition familiale et mettrait chacun sur
un pied d’égalité, il ne faudrait pas
oublier que chaque personne est également
contrainte par l’environnement dont il
provient, notamment familial.
Le phénomène sociologique de «
reproduction sociale » proposé par Pierre
Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans
Les Héritiers, montre que la
position sociale des parents constitue un
héritage pour les enfants. Cette
reproduction peut aussi se retrouver dans
le cadre des métiers.
Selon l’INSEE, en 2014, 47% des fils de
cadres supérieurs étaient eux-mêmes
cadres supérieurs, contre moins de 10%
des enfants d’ouvriers
par exemple.
Verbaliser le projet éducatif via le choix du prénom
Suite à ce constat, il est courant de se
référer à la catégorie
socio-professionnelle (CSP) pour imaginer
la trajectoire éducative et employée d’un
enfant. Olivier Marty propose de se
concentrer davantage sur le projet
éducatif qu’ont les parents pour leur
enfant, plutôt que leur CSP. Par exemple,
les parents qui seraient plutôt de
catégorie socio-professionnelle élevée,
mais qui n’ont pas de projet concret pour
leur enfant, auront donc un enfant qui va
avoir des difficultés à matérialiser ce
projet par des choix de formation et
d’emploi. Alors que dans le cas de parents
qui sont d’une CSP plus modeste, mais qui
ont des ambitions et un projet fort pour
leur enfant, celui-ci va pouvoir plus
facilement s’en emparer et le réaliser. Le
milieu social d’origine n’agirait donc sur
l’enfant et sa condition scolaire que par
l’intermédiaire du projet éducatif des
parents.
Reste à définir ce
qu’on entend par ce « projet éducatif ».
Qu’est-ce que cela veut dire d’avoir un
projet pour son enfant ? Cela peut être
des attentes en termes d’épanouissement,
de bien-être, ou bien de statut ou encore
d’emploi particulier. Dans ses travaux,
Olivier Marty a choisi de se concentrer
sur une variable : le prénom. Celui-ci
manifesterait plus ou moins consciemment
l’intention socioéducative des parents.
Cela peut notamment se refléter dans les
travaux de Baptiste Coulmont, sociologue,
professeur à l'École normale supérieure
Paris Saclay et chercheur à l'Institut des
sciences sociales du politique, qui a mené
une étude qui croise les prénoms, ainsi
que les résultats au bac entre 2012 et
2020.
Une difficulté : avoir un projet en décalage avec l’environnement
L’idéal type étudié ici correspond à un enfant unique qui cherche à devenir ce qu’on attend de lui. L’un des problèmes rencontrés est que l’attente des parents peut se retrouver en décalage avec l’environnement dans lequel évolue l’enfant (école, rencontres, etc.) Or, lorsque l’on rentre en décalage avec son environnement, il y a une difficulté à devenir soi-même. Cela représente la principale inégalité à laquelle les enfants font face. Soit le projet des parents concorde avec l’environnement et les moyens mis à disposition et il ne reste plus qu’à le réaliser aisément, soit le chemin à parcourir sera plus long et difficile.
Ce projet dit de « devenir soi-même » correspond au soi-parental, c’est-à-dire la socialisation primaire effectuée par les parents. Le projet peut entrer en dissonance lors des processus de socialisation secondaire tels que les rencontres, les amis de longue date, etc.
L’école, un instrument parmi d’autres pour se réaliser
Au fond, l’école n’est donc qu’un instrument parmi d’autres pour que l’enfant puisse réaliser les ambitions des parents. Un enfant peut réussir à l’école, car ses parents lui mettent la pression, ce qui peut à la fois être vu par le prisme du soutien des parents, mais également par le prisme de la souffrance face à cette même pression. D’autres élèves vont réussir à l’école, parce qu'il y a une adéquation entre le projet éducatif et leur environnement.
Finalement, l’inégalité scolaire peut être avant tout vue comme une inégalité face aux pressions exercées par la famille dans le cadre du projet éducatif. L’enfant a donc la lourde tâche de devenir qui il est, ce qui est d’autant plus difficile que l’ambition des parents est importante et en désaccord avec l’environnement. Ainsi, tous ne sont pas égaux dans le processus de devenir soi-même, bien que l’école fournisse un socle commun.
Une recherche à approfondir
Il va sans dire que dans le cadre de cette recherche, il y a beaucoup de présupposés tels que les schémas familiaux, la place dans la fratrie… Cette idée que les parents verbaliseraient le projet éducatif sous la forme du prénom qu’ils choisissent de donner à leur enfant ne représente finalement qu’un indicateur parmi d’autres à étudier. Il reste encore à vérifier si cette variable est représentative statistiquement en développant davantage de recherches.
Article publié le 26 janvier 2024.